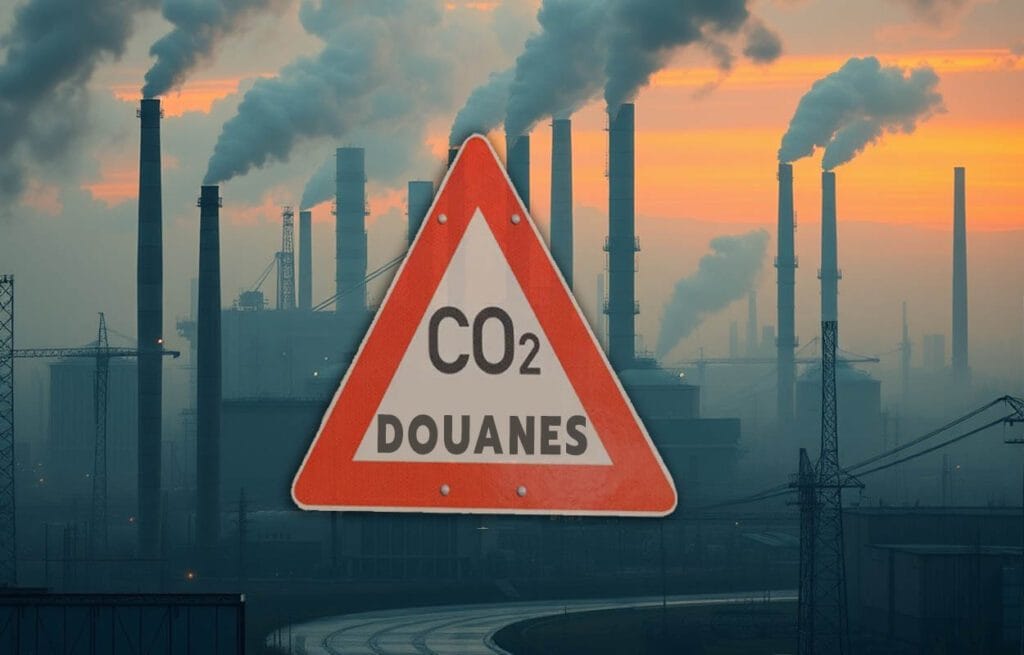Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) mis en place par l’Union européenne suscite des inquiétudes au sein de l’industrie marocaine. Présenté comme un outil environnemental, il est perçu par de nombreux industriels comme une forme déguisée de protection du marché européen.
Abdelkader Amara, président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), a alerté mercredi sur les risques liés à ce dispositif, lors de la présentation de l’avis du Conseil sur le MACF. Selon lui, si l’impact direct reste limité à ce stade — seules 3,7 % des exportations marocaines vers l’UE sont concernées, principalement les engrais azotés —, la mesure pourrait fragiliser certaines filières stratégiques à moyen terme.
Le principe du MACF repose sur un système complexe d’échange de quotas d’émissions de CO₂ : les entreprises européennes qui dépassent leur plafond doivent acheter des quotas supplémentaires, tandis que celles qui émettent moins peuvent vendre leur surplus. « Ce ne sont pas les exportateurs marocains qui paient, mais les importateurs européens », précise Amine Mounir Alaoui, rapporteur au CESE. Toutefois, le rapport souligne que, derrière cette apparente neutralité, le mécanisme impose des normes, des contrôles et des vérifications exclusivement européens, et ignore souvent les systèmes d’échange de quotas existants dans les pays tiers. Résultat : le MACF devient un outil davantage financier que réellement environnemental.
Vers une stratégie nationale proactive
Face à ce défi, le CESE appelle à transformer la contrainte en opportunité. Plusieurs recommandations ont été adoptées :
- Créer un mécanisme national de suivi du MACF, intégrant toutes les institutions concernées pour garantir coordination et réactivité.
- Soutenir les PME exportatrices via un fonds dédié, afin de couvrir les coûts de bilans carbone et d’accompagner la décarbonation des processus industriels.
- Accélérer la transition énergétique des entreprises, avec un accès garanti à l’électricité verte et un suivi précis de l’approvisionnement, notamment pour la moyenne tension.
- Mettre en place un système national de vérification des émissions, reconnu par l’Union européenne, afin de réduire les coûts de certification et de renforcer les compétences nationales en calcul du bilan carbone.
Parallèlement, le Maroc prépare sa propre taxe carbone nationale, construite sur une transformation progressive des taxes existantes pour limiter les chocs économiques, avec un potentiel de recettes estimé entre 2,7 et 3 milliards de dirhams par an.
L’exemple d’OCP : un modèle à suivre
Certaines entreprises marocaines se positionnent déjà en pionnières. OCP Group a investi massivement dans la décarbonation : remplacement du transport ferroviaire par un pipeline, récupération de vapeur industrielle, mise en service d’un parc éolien et ambition d’un approvisionnement 100 % en énergies renouvelables d’ici 2027. À moyen terme, le groupe vise à capter et valoriser 80 % des émissions issues de la production d’acide phosphorique.
Une diplomatie climatique active
Abdelkader Amara plaide aussi pour une action diplomatique coordonnée. Il préconise de renforcer la coopération Maroc-Afrique pour défendre les intérêts des États à faibles émissions et négocier un traitement préférentiel sur le MACF, ainsi qu’une réallocation partielle des recettes des certificats pour soutenir les pays en développement dans leur adaptation aux exigences techniques.
Le temps presse
Avec l’entrée en vigueur du MACF prévue début 2026, le Maroc doit accélérer l’opérationnalisation de sa stratégie nationale bas carbone. L’accès à l’électricité verte et le système national de mesure et vérification restent en chantier. Le défi est clair : transformer une contrainte européenne en levier pour la transition énergétique et la compétitivité industrielle du Royaume, tout en anticipant l’extension du MACF à d’autres secteurs, comme l’automobile ou les produits chimiques, qui pourraient toucher directement des PME et TPE.
Avec Le Matin